Approche sociologique
Sociologie du théâtre : étude de la production et de la réception sociale du spectacle
La sociologie du théâtre s'intéresse à la manière dont le spectacle est à la fois produit et reçu par la société. Elle aborde le théâtre non seulement en tant que produit culturel, mais aussi en tant qu'expérience collective qui touche différentes strates sociales, groupes, et classes sociales à des moments spécifiques de l'histoire. Cette approche s'intéresse à l'interaction entre la représentation théâtrale et les mentalités ainsi qu'aux conceptions idéologiques d'un groupe ou d'une époque donnée.
A. Objectifs et méthodologie de la sociologie du théâtre
Contrairement à d'autres branches des sciences sociales, la sociologie du théâtre ne se concentre pas directement sur l’infrastructure économique liée à l'œuvre, mais cherche plutôt à comprendre le lien entre l’œuvre et la société qui la produit et la consomme. Ainsi, elle se distingue par son enquête empirique, qui peut se focaliser sur plusieurs aspects du théâtre, notamment la structure socio-démographique du public, son capital culturel (un concept développé par Pierre Bourdieu), et la manière dont les spectateurs interagissent avec le spectacle.
Le programme de GURWITCH (1956), prolongé par DUVIGNAUD (1965) et SHEVTSOVA (1993), met en évidence plusieurs axes essentiels pour l'étude sociologique du théâtre :
- L'étude des publics : analyser la diversité des spectateurs, leurs degrés de cohésion, et leur capacité à se structurer en groupes sociaux ou en cibles précises.
- L’analyse de la représentation théâtrale : examiner comment la représentation se déroule dans un contexte social donné, en prenant en compte les facteurs sociaux et historiques qui influencent la mise en scène et sa réception.
- L’étude des acteurs et des troupes : analyser les acteurs non seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que membres d’une profession ou d’une communauté artistique.
- Le rapport entre fiction et société : analyser comment la fiction théâtrale, tant au niveau textuel que scénique, interagit avec la société qui la produit et la reçoit.
- La comparaison des fonctions du théâtre : observer les différentes fonctions que le théâtre peut remplir dans des sociétés variées, selon leur état économique, politique et culturel à un moment donné.
B. Croisement avec l’esthétique de la réception
L'un des apports majeurs de la sociologie du théâtre est sa convergence avec l'esthétique de la réception (notamment les travaux de HANS ROBERT JAUSS, 1978), qui cherche à étudier les attentes du public et à comprendre comment ces attentes influencent la réception du spectacle. Ainsi, la sociologie du théâtre s’intéresse à l’horizon d’attente du spectateur, c'est-à-dire à ses attentes culturelles et sociaux avant de regarder un spectacle.
De plus, le concept de préréceptivité (proposé par DE MARINIS, 1987) permet de comprendre comment les préconditions sociales et culturelles du spectateur influencent sa perception du spectacle. Cela s’inscrit dans une analyse plus large des expériences esthétiques vécues par le spectateur, avec un accent particulier sur la manière dont il comprend et éprouve la représentation théâtrale.
C. Une anthropologie du spectateur et du spectacle
La sociologie du théâtre va au-delà de l’étude des spectateurs pour interroger l’anthropologie du spectacle, c’est-à-dire l’analyse de la manière dont le spectacle agit sur le public au niveau culturel, psychologique, et social. Elle permet ainsi de comprendre comment la pratique théâtrale est à la fois un acte culturel et un acte social, en engageant le spectateur dans une relation dynamique avec la scène.
Jean Duvignaud : Le Sociologue made in france
Jean Duvignaud (1921-2007), sociologue « hérétique » comme il se définissait lui-même, a écrit des ouvrages de sociologie et d’anthropologie, mais aussi des romans et une pièce de théâtre, Marée basse, créée en 1956 par Roger Blin avec notamment Laurent Terzieff dans la distribution.

Le Théâtre : Tribunal des Normes Sociales
Duvignaud, en digne héritier de Durkheim, rappelle une règle universelle : toute société impose des obligations et sanctionne ceux qui les transgressent.
Pendant des siècles, le théâtre a mis en scène cette mécanique sociale. Le personnage qui défie les normes finit souvent puni, que ce soit par un deus ex machina, un roi ou toute autre figure d’autorité venue rétablir l’ordre.
Mais avec le théâtre contemporain et les formes post-dramatiques, cette logique s’efface. Désormais, le spectacle ne se contente plus de juger ses personnages, il laisse place à l’ambiguïté, à l’interrogation, voire à l’absence totale de conclusion morale.
Le Théâtre : Au-Delà de la Sociologie
Duvignaud le martèle : le théâtre ne se réduit pas à une simple analyse sociologique. Il ne se contente pas de refléter la société, il la dépasse, la questionne, la bouscule.
Bien plus qu’un phénomène social, il est une fenêtre ouverte sur les grandes forces qui traversent l’humanité : la mort, la faim, le désir, la violence. Il exprime, à travers ses personnages marginaux et ses courants artistiques contestataires (comme le dadaïsme), les tensions et aspirations d’une société en mutation.
L’enjeu pour le sociologue n’est donc pas seulement d’étudier les structures du théâtre, mais d’en saisir la portée critique et visionnaire, souvent inconsciente, qui façonne notre manière de voir et d’imaginer le monde.
Le Théâtre : Une Expérience Concrète, Pas Juste une Histoire
Plutôt que de chercher une essence ou une origine figée du théâtre, Duvignaud insiste sur l’importance d’étudier la pratique théâtrale elle-même, en tenant compte de toutes ses dimensions : économiques, psychiques, techniques.
Le théâtre moderne, selon lui, naît d’une révolution technique et artistique. « La dramaturgie moderne, c’est l’électricité plus le metteur en scène », affirme-t-il. Avec l’amélioration de l’éclairage au XIXe siècle, les acteurs ne sont plus seulement éclairés par en dessous, leur jeu gagne en expressivité, l’espace scénique se transforme. Cette mutation donne naissance à une nouvelle figure essentielle : le metteur en scène, chef d’orchestre du spectacle, qui harmonise lumière, décor, musique et jeu des comédiens.
Le Théâtre : Un Laboratoire Social
Pour un sociologue, le théâtre est un « fait social total », comme l’aurait dit Marcel Mauss. Il reflète la société dans toute sa complexité, du collectif à l’individuel, du visible à l’inconscient.
Tout y est matière à analyse : les dialogues, la mise en scène, les interactions entre acteurs et spectateurs, les gestes, les regards. Même les conventions théâtrales – silence dans la salle, applaudissements, rideau qui tombe – évoluent avec les époques et les cultures. Bref, le théâtre est bien plus qu’un divertissement, c’est un miroir dynamique des relations humaines et des transformations sociales.
Le Théâtre : Un Cri Contre l’Ordre Établi
Selon Duvignaud, le théâtre ne se contente pas de refléter la société, il lui répond, la questionne, la défie. Il exprime les tensions d’une époque, une révolte contre un ordre établi.
C’est pourquoi on y trouve souvent des personnages marginaux, inquiets, en colère, en crise. Ils incarnent une société en mutation, où les repères vacillent et où les normes sociales ne sont plus tout à fait fixées. Le théâtre devient alors le lieu où ces bouleversements prennent corps et voix.
Le Théâtre n’a pas le Monopole du Spectacle
Pour Duvignaud, si tout théâtre est un spectacle, tous les spectacles ne sont pas du théâtre. Il met en garde contre le "théâtrocentrisme", cette tendance à voir du théâtre partout, alors que d'autres formes spectaculaires existent avec leurs propres codes.
C'est sur cette idée qu'il fonde, en 1995 avec Jean-Marie Pradier, l'ethnoscénologie, une discipline qui étudie les pratiques spectaculaires du monde entier, sans les réduire au modèle théâtral occidental.
L’ethnoscénologie est née lors d’un colloque organisé par l’UNESCO à la Maison des cultures du Monde. Son but ? Étudier les pratiques spectaculaires du monde entier sans imposer le regard occidental et sans réduire ces formes à un simple "théâtre".
Jean-Marie Pradier définit cette discipline comme une approche transdisciplinaire, cherchant à éviter tout ethnocentrisme – qu’il soit linguistique (imposer un mot d’une langue à une autre), disciplinaire (penser que seule une science détient la vérité) ou même genré (faire primer un regard masculin sur l’ensemble).
Duvignaud et Pradier s’opposent à ce qu’ils appellent le "théâtrocentrisme", une tendance de certains sociologues et anthropologues à interpréter toutes les formes spectaculaires à travers le prisme du théâtre occidental. Contrairement aux philosophes des Lumières qui voyaient le théâtre comme universel, l’ethnoscénologie rappelle qu’il n’a pas existé partout ni sous la même forme.
Théâtre et société : une frontière poreuse
Duvignaud souligne la porosité entre théâtre et société, notamment à travers la notion d’acteur, un concept central en sociologie. Étymologiquement, l’acteur est "celui qui agit", et la sociologie l’envisage sous plusieurs angles : ses motivations (Weber, 1922), ses interactions (Parsons, 1952), sa rationalité (Boudon, 1983) ou encore son rôle au sein des organisations (Crozier, Friedman, 1977).
Dans son sens théâtral, l’acteur est celui qui joue un rôle sur scène, une situation que la sociologie du théâtre analyse depuis longtemps (Duvignaud, 1965). Or, certains sociologues négligent le recouvrement entre ces deux acceptions, tandis que d’autres, comme Michel Maffesoli, en font un outil d’analyse. Selon lui, l’acteur social n’est pas seulement celui qui agit, mais aussi celui qui joue un rôle devant autrui, soulignant ainsi la part de mise en scène inhérente à la vie sociale.
Conclusion : La sociologie du théâtre en tant qu’objet de recherche
Le théâtre en tant qu’institution sociale mérite une exploration à travers diverses disciplines des sciences humaines et sociales :
- Psychologie sociale pour les dynamiques internes à la troupe,
- Science politique pour analyser la censure et les politiques culturelles,
- Histoire culturelle pour l’évolution de sa fréquentation publique,
- Économie pour les paradoxes du financement,
- Droit du travail pour les rapports salariés-employeurs.
La sociologie du théâtre se situe donc à l’intersection de plusieurs domaines, rendant difficile son confinement à un seul champ scientifique, même si elle s’impose dans certains pays comme l’Allemagne et la Belgique. Elle doit inclure une sociologie du travail, des publics, des œuvres, en étudiant tant la production que la réception, la diffusion, la formation et la médiation. Le théâtre sera aussi abordé par rapport à d’autres arts, médias et pratiques culturelles.
En résumé, c’est l’interaction sociale au sein du phénomène théâtral, à différentes échelles, qui intéresse les sociologues : entre membres de la troupe, entre comédiens et metteur en scène, entre œuvres et spectateurs, ou encore entre compagnies et institutions.
Références bibliographiques
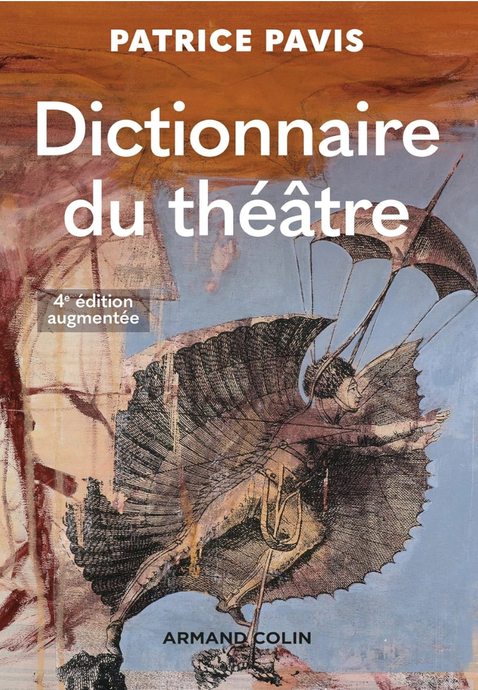

Créez votre propre site internet avec Webador